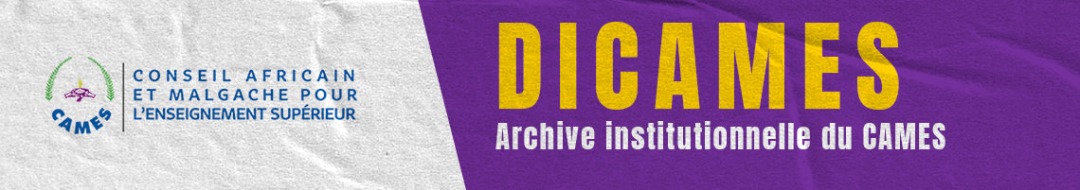
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13043Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Houvenaghel, Guy | - |
| dc.contributor.advisor | Wolff, Eléonore | - |
| dc.contributor.author | Assi Kaudjhis, Joseph-Pierre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2005-12-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13043 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail analyse les facteurs qui inhibent le développement durable de l’aquaculture en Côte d’Ivoire, voire en Afrique subsaharienne. L'approche hypothético-déductive, nourrie d’enquêtes de terrain et de recherches bibliographiques, choisie pour mener l'étude a consisté à analyser le développement de cette activité à différentes échelles spatio-temporelles et à répondre globalement aux trois préoccupations suivantes : Comment les activités de pisciculture s’insèrent-t-elles dans le milieu rural ivoirien et dans les systèmes de production paysans ? Quels sont les effets induits par cette insertion ? Pourquoi en dépit du potentiel naturel et humain dont elle dispose, la Côte d’Ivoire ne parvient-elle pas encore à développer son secteur aquacole pourtant qualifié d’essentiel à la réduction de sa dépendance vis-à-vis des pêcheries étrangères, à sa sécurité alimentaire et au développement de son milieu rural ? C’est dans le milieu des années 70, à la faveur des politiques orientées vers la diversification agricole et l’amélioration des revenus des ruraux, mais aussi et surtout vers la sécurité alimentaire, qu’une priorité suffisante va commencer à être accordée à cette activité dans les plans de développement économiques et sociaux de la Côte d’Ivoire. Diverses initiatives de vulgarisation vont ainsi être menées avec l’assistance technique et financière des organismes de coopération internationale. Exécutés, dans les premières heures de leur mise en œuvre, à l’échelle nationale, ces projets piscicoles vont, depuis le début des années 1990, suite aux restructurations survenues dans les politiques de développement agricole, de plus en plus être organisés au niveau régional. Même s’ils ont parfois ouvert des perspectives encourageantes en termes d’émergence d’un dynamisme aquacole local, les résultats de ces projets restent dans l’ensemble encore mitigés à l’échelle nationale pour plusieurs raisons. Sur le plan technique par exemple, bon nombre de modèles techniques vulgarisés, et notamment les systèmes productivistes, ont encore du mal à être réappropriés par les populations rurales. Au niveau de l’encadrement, de nombreuses difficultés subsistent également. Le secteur piscicole ne bénéficie pas en effet d’un ajustement permanent compte tenu de l’insuffisance des moyens alloués aux structures locales d’appui. Cette situation s’est durcie avec les convulsions socio-politiques actuelles. Tout ceci produit des dysfonctionnements qui menacent sérieusement les perspectives tant escomptées, de professionnalisation voire d’autonomisation de l’activité. Et pourtant, celle-ci recèle un potentiel non négligeable dans ce pays qui, bien exploité, pourrait significativement contribuer à réduire sa dépendance halieutique et améliorer son économie. A l’échelle locale en effet, quelques résultats porteurs s’observent déjà. Mais ceux-ci sont encore bien trop limités spatialement pour avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble du territoire. Pour faire du secteur aquacole un domaine porteur de l’économie ivoirienne, il importe que des solutions soutenables et appropriées soient apportées aux problèmes qui freinent son développement. Globalement, celles-ci se résument à l’amélioration de l’encadrement, à une participation étroite des producteurs dans l’élaboration des politiques piscicoles et surtout des modèles techniques, à la définition de lignes de financements, à la sécurisation des droits fonciers et au développement global de l’agriculture. La mise en œuvre durable de ces mesures ne peut cependant se faire que dans un contexte politique et social relativement stable. | fr_FR |
| dc.format.extent | 369 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Libre de Bruxelles | fr_FR |
| dc.subject | Aquaculture | fr_FR |
| dc.subject | Afrique subsaharienne | fr_FR |
| dc.subject | Etude géographique | fr_FR |
| dc.subject | Côte d’Ivoire | fr_FR |
| dc.title | Etude géographique de l’aquaculture en Afrique subsaharienne : exemple de la Côte d’Ivoire | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_225_These_Joseph_Pierre_Assi_Kaudjis.pdf | 6.89 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.